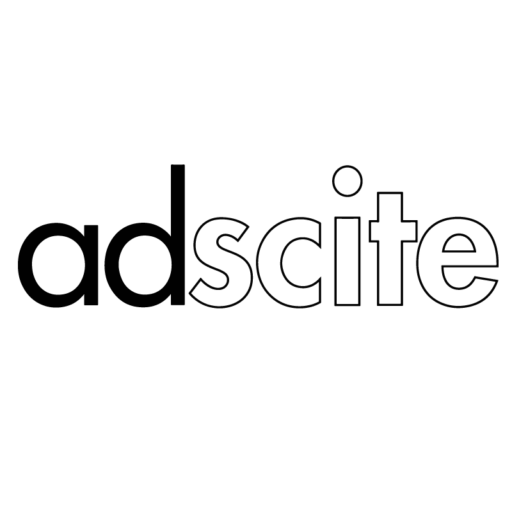Thomas Roussel, plasticien de la musique


Rencontre avec Thomas Roussel, musicien pluriel au talent manifeste, qui s’applique à donner à la musique classique un coup de fouet contemporain. Thomas Roussel ne se pose aucune limite : il collabore avec Karl Lagerfeld, avec les grandes maisons Dior et Chanel, entre autres projets mode ; il compose pour Jeff Mills ou encore Ed Banger ; il s’acoquine avec le milieu du cinéma ; enregistre dans les plus grands studios ; se solidarise au monde de l’art avec Loris Greaud et Daniel Arsham; etc. Retour sur la carrière de Thomas Roussel, de ses débuts au conservatoire à son projet très personnel nommé Prequell, en passant par de nombreuses collaborations, à travers un portrait singulier.
Il me semble que tu as commencé la musique assez jeune, m’abusé-je ?
Mon père étant musicien, dès trois ans j’ai ressenti comme un appel de la musique. Puis, très vite, je suis devenu boulimique, je voulais jouer de tous les instruments, je ne me posais aucune frontière, mais heureusement mes parents veillaient. Ils ont su me limiter à trois instruments afin que je ne m’éparpille pas bêtement. L’apprentissage de la musique était un moteur dingue pour moi, j’ai dévoré mes classes au conservatoire, pour apprendre à jouer, mais également à composer et orchestrer.
Tes parents t’ont limité à trois instruments, quels étaient-ils ? L’un d’eux t’a-t-il plus motivé ?
D’abord le violon, puis le piano et un peu plus tard l’orgue d’église. Ce dernier, avec tous ses « boutons » me fascinait. Néanmoins, pour être honnête, ce qui me motivait le plus c’était l’écriture musicale. Les classes qui m’ont le plus ouvert les oreilles, la tête et le cœur sont celles de composition et d’orchestration. Enfant, je ne le savais pas encore, mais cette prédominante passion me permettrait, après quelques ellipses, de très vite travailler. De vingt à trente ans, j’ai pu bosser pour d’autres, surtout pour le cinéma, en tant qu’arrangeur, qu’orchestrateur, et parfois même ghostwriter, en dix ans j’ai ainsi pu faire plus d’une dizaine de films.
N’était-ce pas frustrant d’œuvrer pour les autres à cette période, et de ne pas être « Thomas Roussel » ?
Heureusement, en parallèle de ces projets, je trouvais de quoi m’épanouir personnellement. Par exemple, j’ai monté avec Loris Greaud, un talentueux artiste contemporain, un opéra pour Radio France ; je m’occupais des arrangements pour la Star Academy ; je collaborais avec Roberto Alagna. Le boulot ne manquait pas. Puis, est arrivé SomethingALaMode, un projet électro un peu cheesy où avec mon ami d’enfance, Yannick Grandjean, nous agrémentions les morceaux de véritables parties en violon et violoncelle. Pour SomethingALaMode, tout est allé très vite, avant même que l’album ne sorte, Karl Lagerfeld nous a chargé de faire la bande son d’un défilé Chanel. Ce tremplin, assez inattendu, nous a aspiré pendant quatre ans où nous avons pu voyager dans le monde entier, faire vraiment beaucoup de concerts. Seulement, le fait d’être repéré par Karl Lagerfeld, de lui être affilié, ce qui est un véritable honneur, me mettait dans la même situation que lorsque je travaillais pour d’autres. En nous offrant cette immense chance, Karl nous avait comme placé sous son ombre sans le vouloir.
Pensais-tu perdre en légitimité avec cet appui ?
Non, mais avec le temps le projet était devenu comme autre. Néanmoins, j’ai pu expliquer à Karl que je faisais autre chose en dehors de SomethingALaMode. Et ainsi, j’ai pu commencer à véritablement œuvrer pour la mode, à faire de véritables live avec des orchestres lors de défilés. Mais encore une fois, je me retrouvais dans cette éternelle situation : bosser pour les autres. Comme pour le cinéma, où je devais déjà : bosser pour les autres. Mais attention, ce n’est pas nécessairement négatif, c’est aussi très agréable de faire corps avec une équipe, un ensemble de métiers différents.
Parlons un peu de Thomas Roussel au cinéma justement. Les films pour lesquels tu travailles n’ont pas tous les mêmes budgets, les mêmes libertés à t’offrir. Peux-tu nous donner tes sentiments face à cette partie de ta carrière ?
Alors je vais commencer par un principe qui me semble étonnant mais plutôt exact, j’ai l’impression d’être plus libre sur les films où le budget est limité. D’ailleurs, en 2012, j’ai eu la chance de faire l’un des plus petits et l’un des plus gros films de l’année en France. Le premier, « La Pièce Manquante » de Nicolas Birkenstock avec Philippe Torreton, était très musique de chambre, j’ai adoré écrire ce projet où j’étais très libre. En face, le second, « Eyjafjallajökull » de Alexandre Coffre avec Dany Boon et Valérie Bonneton, était lui très financé, j’ai pu enregistrer au Air Studios, à Londres, avec la même équipe que Hans Zimmer. Néanmoins, même si j’ai eu moins de liberté sur « Eyjafjallajökull », j’ai trouvé la collaboration avec Alexandre Coffre très enrichissante. Il trouvait que son film était comme en déficit d’émotions, et pour rehausser la tension il comptait beaucoup sur la musique afin de ramener les intentions qu’il avait avant le tournage.
Au-delà de ces deux cas, quel est ton sentiment général sur ta musique au cinéma ?
À presque quarante ans, j’ai vraiment le désir de m’affirmer en sélectionnant les projets qui m’offrent la possibilité de faire véritablement du Thomas Roussel et non plus du Thomas pour X, du Thomas pour Y. Je pense être maintenant assez mature pour proposer une véritable direction artistique, une signature. C’est pour cela que depuis deux, trois, ans je refuse toutes les comédies ou les projets qui ne correspondent pas à mes attentes. Cependant, j’ai accepté un film qui sortira l’année prochaine, celui-ci me permet de rester dans mon esthétique, c’est très gratifiant en tant qu’artiste.
Revenons sur la partie mode. Tu as œuvré pour un nombre important de défilés, pour Chanel, Dior, Michael Kors, Valentino, Akris, Kenzo, etc. Comment t’exprimes-tu via les plateaux de mode ?
Je tente de proposer, au maximum, du live, pour transmettre une émotion avec puissance. J’ai dû faire trois défilés où ma musique était seulement diffusée, et la grandeur apportée est nettement moindre. Le live accentue tout. Généralement, je collabore avec Alexandre de Betak, du Bureau Betak, et Etienne Russo, de villa eugénie. Les deux, malgré leurs différences, ont un unique but : la transmission d’émotions vives. Ainsi, le fait d’avoir de véritables musiciens sur le plateau, des hommes et des femmes qui intègrent alors de facto la mise en scène globale, est un véritable accélérateur émotionnel. Sinon, pour revenir à ma façon de m’exprimer, des contraintes imposées par les marques peuvent être très appréciables. Par exemple, en juin 2017, pour le défilé Pigalle Paris et NikeLab, au Musée d’Art Moderne de Paris, je ne devais user que d’instruments en métal. Ainsi, j’ai pu amener des choses moins communes, un peu extravagantes, sur la scène, c’était génial.
La mode m’offre une sorte d’antichambre de la création. Je peux y tester des choses en grande liberté, aussi bien pour la composition que pour la scénographie et la disposition des musiciens. La dynamique d’un défilé fait que le stresse est important, on doit parfois revoir des choses à la dernière minute. C’est très stimulant de fuser ci et là pour obtenir un résultat optimal.
As-tu remarqué des différences entre tes actions aux fashion week de Paris et celles de New York ?
Oui, mais je ne sais pas précisément si c’est une différenciation entre les villes ou les marques pour lesquelles je travaille. Au début, lorsque j’opérais pour Michael Kors à New York, j’ignorais un peu la portée de la marque aux États-Unis. Pour moi c’était une marque moins connue que Chanel. Pourtant, l’impact de Michael Kors là-bas est impressionnant. Ainsi, moi qui m’attendais à ne pas disposer de gros moyens, j’ai eu l’occasion de mettre en scène des choses très intéressantes avec eux et Alexandre de Betak, comme pour la collection Automne/Hiver 2017-2018 où la scénographie réquisitionnait vingt musiciens debout, comme pour un orchestre baroque. Le fait d’avoir ces musiciens au milieu du set offrait beaucoup d’impact, c’était puissant. Plus qu’un orchestre en arc de cercle autour du « Chef ».
C’est quelque chose que tu recherches beaucoup, l’impact visuel, sinon sensoriel, de la disposition scénographique de tes musiciens. As-tu des projets marquants à citer ?
Mes collaborations avec Dior, sous l’impulsion de Etienne Russo. Pour le défilé Automne/Hiver 2015-2016 à Paris, j’ai pu faire jouer un orchestre en ligne droite. Puis, pour cette même collection, j’ai pu conceptualiser une disposition en cercle pour les musiciens lors du défilé à Guangzhou en Chine. D’autres scénographies sont très marquantes, mais celle-ci reste très intéressante pour son côté polymorphe.
Passons à Prequell, qui est un peu le nouveau nom de scène de Thomas Roussel, si je ne m’abuse. Avant d’aborder l’album, je vais revenir sur « Debut », le premier EP du projet, qui compte cinq titres. Pourquoi sélectionner cinq morceaux purement instrumentaux alors que des voix émaillent l’album ?
J’avais besoin de dire, avec Prequell, et plus particulièrement avec « Debut », que, sans attentes précises d’un directeur artistique extérieur, d’un réalisateur, d’un producteur, ou tout autre commanditaire, Thomas Roussel seul c’est ça. « Debut » c’est l’ADN de mon univers. Surtout le morceau « Part V ». Je voulais le concevoir comme une explosion, avec mes univers harmoniques, rythmiques, mélodiques, etc. Bref, avec mes gimmick… Et surtout, je ne souhaitais pas l’entourer d’éléments perturbateurs qui pourraient brouiller mon discours. Pour être précis, j’ai fait un EP avec cinq titres instrumentaux mais je savais néanmoins que l’album compterait des voix par le biais de featuring car mes références étaient alors Massive Attack, Craig Armstrong, ou encore Bjork.
L’enregistrement de l’album sous le nom Prequell s’est fait « à la royale ». Peux-tu revenir sur les différentes étapes de la conception de « The Future Comes Before » ?
Je pourrais résumer par cette phrase : « J’ai eu de gros coups de chances ». Sans mentir, j’avais des ambitions énormes avec cet album, je voulais proposer quelque chose de très abouti. Ayant déjà collaboré avec le studio de Isobel Griffiths à Londres pour « Eyjafjallajökull », j’ai décidé d’y retourner pour Prequell. Et, le soir même de notre retour à Paris, j’ai reçu un appel pour un projet de brand content. On me proposait de faire la musique de cinq films pour une marque. Le bonus étant qu’un des films allait être sur moi. La marque désirait montrer les gens à l’ouvrage, et pour mon métier, le plus visuel, c’est voir quelqu’un diriger un orchestre. Alors j’y suis allé au bluff, j’ai accepté en disant que je désirais le faire au Abbey Road Studios avec le London Symphony Orchestra. Ce que la marque a accepté. Avec mon manager, nous avons alors contacté le LSO et, encore une fois, tout s’est enchainé merveilleusement bien. Au bout du fil, la personne me dit : « Nous venons de voir sur Instagram que tu avais enregistré avec Isobel Griffiths. C’est bon pour nous ». J’ai ainsi pu enregistrer cinq nouveaux morceaux avec le LSO. Je me suis pris une très grosse claque, c’était un intense moment d’émotion, j’enregistrais avec le meilleur orchestre au monde. Celui de Star Wars, celui que j’admirais en reportage lorsque j’étais enfant. J’avais soixante-dix musiciens devant moi, je complexais face à ces pointures. Je suis bon violoniste, mais très loin du génie. Je feintais que tout allait bien, mais au fond de moi-même j’étais à nouveau un gosse en plein rêve.
Après ma collaboration avec Isobel Griffiths puis le London Symphony Orchestra dans deux studios mythiques, on m’a conseillé de faire mixer « The Future Comes Before » par Steve Fitzmaurice. Le mixeur multi récompensé de Depeche Mode, Sam Smith, Sting, etc. Steve a trouvé le projet cool, donc il a accepté puis, sans même nous demander, il a envoyé le tout en mastering au Sterling Sound. Lieu qui gère les albums de Adèle, Beyoncé, etc. Ainsi, je me retrouve avec une chaîne de production dingo, comme j’en rêvais.
Passons aux featuring, l’album en compte cinq, comment as-tu sélectionné les différents profils ?
Déjà, je ne voulais pas d’une démarche internet, je voulais être en studio avec eux. Pour la sélection, disons que pour quatre sur cinq, tous sauf Claire Laffut, c’était des petits crush sur Spotify. Je ne voulais pas faire appel à ceux qui avaient marqué la période Massive Attack dont je suis fan. Par exemple, j’avais déjà collaboré avec Tracey Thorn, la chanteuse de Everything but the Girl, et artiste récurrente de Massive Attack. J’aurais pu lui écrire pour lui demander de participer à l’album, mais non. J’approche des quarante ans, et plutôt que d’aller chercher des gens qui m’avaient fait rêver quand j’étais jeune, j’ai préféré partir à la recherche de talents plus « neufs» pour apporter une véritable fraicheur à « The Future Comes Before ». Je ne voulais rien imiter, je ne voulais pas faire du Massive Attack ou du Bjork rechauffé.
Avec Claire Laffut, c’est différent, nous sommes amis depuis plusieurs années, et en plus d’évoluer dans la musique elle peint également. Un jour, elle me rendit visite en studio pour me montrer des dessins pour éventuellement illustrer l’album. En entendant un morceau, Claire me demanda si elle pouvait chanter dessus. Ayant prévu ce titre comme seulement instrumental, j’hésitais. Elle sortit quand même son calepin est commença à écrire des paroles. Moi, je sortis donc un micro pour tester. Résultat… Eh bien le résultat fut magique.
Peux-tu parler de ta scénographie, la sculpture numérique « Ammonite », réalisée par le studio Scale ?
J’avais beaucoup de références picturales, comme le travail de Loris Greaud et de Daniel Arsham. D’ailleurs, avec ce dernier, nous allons réaliser le prochain clip pour Prequell. Dans mes références, les lumières et les néons étaient très présents. J’aimais l’idée d’une lumière froide dans un univers sombre. Également, la pochette de l’album « As If To Nothing » de Craig Armstrong, où l’on voit comme des néons posés à la verticale dans une sorte de mer grise et menaçante était une référence très présente. Jean-François Wang, qui est responsable de l’image de mon album, m’a de son côté proposé de nombreux artistes. C’est avec le collectif Scale que j’ai eu la plus grande affinité. « Ammonite » était déjà une pièce existante que j’adorais, je leur ai demandé une installation dans la même ligne, et ils m’ont alors directement proposé « Ammonite ». J’étais super content, je n’avais pas besoin d’attendre une commande spéciale, et surtout je ne risquais pas d’être déçu avec une œuvre que j’aurais trouvé moins intéressante que celle-ci. « Ammonite » dégage la parfaite émotion pour mon projet : elle peut rappeler mes placements de musiciens, ou encore mes collaborations sur des défilés ; elle souligne mon goût pour l’art contemporain et elle affirme ma passion pour les installations visuellement puissantes.
Tu as utilisé « Ammonite » sur plusieurs scènes, comment vois-tu la suite de l’exploitation de ta scénographie ?
J’ai donné plusieurs concerts avec cette œuvre, mais elle appartient toujours au collectif Scale, et tourner avec est assez compliqué. Ainsi, depuis peu, j’ai confié ma scénographie au collectif Super Bien. J’avais déjà collaboré avec eux sur un événement Dior Haute Joaillerie à l’Opéra royal du château de Versailles, Super Bien s’occupait du mapping du lieu et c’était magnifique. Pour Prequell, ils ont fait des sortes de tubes de led connectés en wifi qui peuvent autant servir de light que de projecteurs vidéo, c’est hallucinant. Avec cette nouvelle scéno, j’ai quelque chose de propre à mon projet avec lequel je peux plus aisément tourner, c’est parfait.
Quelles sont les influences culturelles présentes sur « The Future Comes Before » ?
Je pense que mes goûts sont symptomatiques de mon enfance, des choses très pop, très 80s et 90s. Disons que le nom qui revient le plus c’est Daniel Arsham, je suis très amateur de son délire de vieillir des objets du quotidien, des choses très pop comme des appareils photo, des claviers, des guitares… Face à ses œuvres, je fais un bon dans le temps, je saute vers le futur et regarde notre époque dégradée. Avec les œuvres de Daniel Arsham, je vois les années 2010 comme Pompéi, ça m’émeut profondément.
Aussi, le livre « L’Univers à portée de main » de Christophe Galfard m’a captivé. Cet ancien étudiant de Stephen Hawking a su vulgariser et résumer les échelles de grandeur dans l’univers, ça confronte l’Homme à l’infiniment petit, à l’infiniment grand, c’est passionnant. Ce livre m’a d’autant plus motivé à intégrer des sons de la NASA dans l’album.
Peux-tu parler de ta collaboration avec Ed Banger où, pour les quinze ans du label, tu vas reprendre avec un orchestre une sélection de titres pour une date unique ?
C’est très excitant, ça me rappelle ma collaboration avec Jeff Mills autour de la pièce « Blue Potential » pour laquelle j’ai fait la composition, les arrangements et l’orchestration. Depuis, l’œuvre a évolué, elle s’appelle désormais « Lights From The Outside World » et elle est jouée quasiment tous les mois depuis douze ans dans le monde entier. Je n’aurais jamais cru, à vingt-quatre ans, que cela prendrait une telle dimension. Je parle de cette expérience car à la différence de celle-ci où Jeff Mills est présent sur scène pour jouer les beat, cette fois-ci avec Ed Banger, le postulat de départ convenu avec Pedro Winter est full symphonique. Pour les quinze ans, je dispose de soixante-dix musiciens sans aucune machine. Je trouve cela très couillu de la part de Ed Banger, un label de musique qui tape.
Pour ce qui est de la production, afin de ne pas déposséder les artistes de leurs œuvres, je les invite à venir en studio afin de recueillir leurs avis. Je trouve très amusant de muer un morceau de Justice en simili Steve Reich avec du marimba, du piano et de la flute traversière. Mais ça, c’est aussi la force de Pedro Winter, il a un enthousiasme fou, quand tu le vois tu saisis aussitôt que le type arrive à déplacer des montagnes depuis plus de vingt ans.
Alexandre Fisselier